
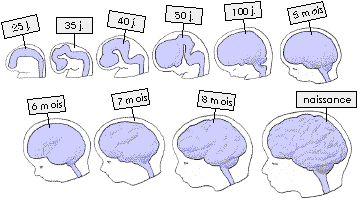
L'embryogénese du cerveau.
Une journée après la fécondation, le zygote entreprend une série de divisions mitotiques par lesquelles le volume considérable de cytoplasme de l’ovule est répartit en plusieurs cellules filles. Il n’y a donc pas de croissance de taille durant ces premières divisions cellulaires qui font passer l’embryon successivement au stade de 2, 4, 8, puis 16 cellules qu’on appelle blastomère. On parle de segmentation pour désigner cette première phase du développement embryonnaire caractérisée par une suite de divisions rapides et rapprochées.

Le stade de 16 cellules, aussi appelé morula, est atteint au troisième jour après la fécondation chez l’humain. À ce stade, l'embryon est une boule compacte de cellules qui descend dans les trompes de Fallope vers l'utérus. Les divisions n'ont toujours pas entraîné d'augmentation de la taille de l'embryon par rapport à l'ovule initial
La troisième semaine de développement débute par une réorganisation cellulaire importante : la gastrulation. La blastula va subir une invagination, c'est-à-dire qu'une portion des cellules de surface de la sphère va pénétrer à l'intérieur de celle-ci, formant ainsi l’endoderme, tandis que les cellules demeurant à l’extérieur vont former l’ectoderme. Les cellules à l'intérieur de la sphère vont ensuite se diviser en deux feuillets de cellules formant deux disques superposés. Celui du dessus deviendra l’embryon alors que celui du dessous se transformera en un sac vitellin fournissant des éléments nutritifs en attendant un système circulatoire fonctionnel.

Toutes les cellules de ces couches ont le même matériel génétique, mais certaines commencent à exprimer certains gènes plus tôt que d’autres afin de développer différents organes. L’endoderme, la couche la plus intérieure, produira les intestins, les poumons et le foie. Le mésoderme, la couche mitoyenne, donnera naissance aux reins, aux organes reproducteurs, aux os, aux muscles et au système vasculaire. Et l’ectoderme, la couche qui nous intéresse,à l'extérieure, sera à l’origine à la fois de l’épiderme et de tout le système nerveux central et périphérique.

Environ 3 semaines après sa conception, le cerveau humain n’est qu’une simple couche de cellules aplaties de l’ectoderme appelée plaque neurale. On assiste par la suite à la formation d’un sillon qui s’étend de la partie rostrale à la partie caudale de cette plaque. Les parois de ce sillon neural vont ensuite former une gouttière neurale dont la fermeture, d’abord en son milieu puis dans sa partie antérieure et postérieure, va former le tube neural. Des cellules de la partie dorsale de ce tube deviendront quant à elles la crête neurale, structure à l’origine de neurones du système nerveux périphérique.
Les cellules les plus éloignées dorsalement de la plaque neural donneront pour leur part les neurones sensitifs.
Le processus de formation du tube neural, qui débute souvent avant même que la mère sache qu’elle est enceinte, est nommé neurulation. C’est à partir de ce tube que se développeront le cerveau et la moelle épinière qui sont alors les organes les plus développés de l’embryon et qui lui donne sa forme incurvée caractéristique. À la fin de la troisième semaine, les yeux et les oreilles auront aussi commencé à se former.


Au début de la 4ème semaine après la fécondation, le tube neural se ferme complètement, achevant la première étape de développement du cerveau et de la moelle épinière. L’étape suivante, l'histogenèse, c’est-à-dire la différenciation cellulaire à partir de cellule souche, qui mène à la formation des tissus nerveux, va pouvoir commencer pour de bon. Elle se fera en parallèle avec la formation des grandes subdivisions du cerveau et le réarrangement des populations cellulaires qui s’ensuit.
L'histogenèse se produit en trois étapes, prolifération, migration et différenciation.
Dans la prolifération, la paroi du tube neural est faite de cellules souches qui par divisions mitotiques augmentent progressivement l'épaisseur de celui-ci. Les cellules qui se divisent sont situées dans la partie profonde de la paroi, proche de la lumière du tube. Lorsque la division s'est opérée, les cellules filles se déplacent vers la périphérie du tube neural. Cette prolifération se poursuit pendant les deux ou trois premiers mois de la vie intra-utérine et conduit à un épaississement du tube neural. A partir du moment où les cellules filles ont quitté la zone profonde du tube, leur destin est strictement déterminé. Elles peuvent donner les deux catégories de cellules constituant le système nerveux: soit des neurones immatures appelés neuroblastes soit des cellules gliales immatures appelées glioblastes.


Dans la migration, les neuroblastes deviennent des neurones matures au cours des mois suivants en rejoignant leur destination finale par migration et en acquérant des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles propres aux neurones par un processus de différenciation.
Les cellules gliales subissent elles aussi un processus de différenciation.
La migration des neurones se fait de la partie profonde de la paroi du tube neural vers la partie périphérique en utilisant une forme particulière de cellules gliales, que l'on ne rencontre que pendant le développement du système nerveux et qui disparaît chez l'adulte. Chacune de ces cellules possède un prolongement qui traverse toute l'épaisseur du tube neural. Ces prolongements constituent un support sur lequel les neuroblastes en migration s'accrochent et migrent.
Dans la différentiation, une fois que les neuroblastes ont migré jusqu'à leur position finale, ou même en cours de migration, ils émettent un prolongement qui s'allonge rapidement par son extrémité appelé le cône de croissance. Ce prolongement est l'axone du neurone. L'axone pousse en direction d'une région cible du système nerveux en formation pour établir des contacts synaptiques avec d'autres neurones. La croissance des axones fait intervenir le cône de croissance qui interagit avec l'environnement et détecte des signaux de guidage, émis par la région cible.



Parallèlement à l'élongation de l'axone, des prolongements plus courts que l’axone et très ramifiés sont émis par le neurone : ce sont les dendrites qui servent à recevoir des contacts en provenance d'autres neurones.
La formation de l’encéphale commence par la subdivision du tube neural en trois vésicules primaires, puis en cinq vésicules secondaires. Le vésicule le plus rostral, le télencéphale, voit deux bourgeonnements jaillir de sa partie antérieure. Ces deux vésicules télencéphaliques prendront rapidement de l’ampleur pour former les deux hémisphères cérébraux.
Les neurones de la paroi du télencéphale prolifèrent et forment trois régions distinctes : le cortex cérébral, le télencéphale basal et le bulbe olfactif.
Les axones de ces neurones vont aussi s’allonger progressivement pour communiquer avec les autres parties du système nerveux. Certains constitueront la substance blanche corticale qui part de neurones du cortex ou s’y projette. D’autres formeront le corps calleux, ce pont axonal entre les deux hémisphères. D’autres enfin, ceux de la capsule interne, relieront la substance blanche corticale au tronc cérébral généralement via le thalamus. Les axones des neurones moteurs du cortex passeront par exemple à travers la capsule interne pour rejoindre les moto neurones de la moelle épinière.
L'espace restant entre le télencéphale et le diencéphale donne naissance aux ventricule cérébraux. L’espace situé au centre du diencéphale forme le troisième ventricule. Les deux ventricules latéraux sont aussi appelés le premier et deuxième ventricule.
Le diencéphale se différencie également en deux territoires distincts : le thalamus et l’hypothalamus.
Nous savons maintenant, comment le cerveau se développe, nous allons voir ensuite, comment celui ci participe à la préférence manuelle.